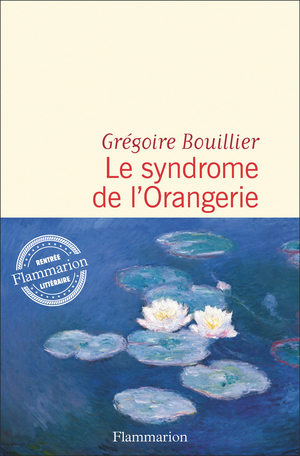Ça y est, on tient le navet du siècle ! Et c’est du lourd ! Un vrai foutage de gueule ! Complètement grotesque, ridicule, creux, vide, sans aucun intérêt, vulgaire, une espèce de film d’horreur de seconde zone... THE DAUBE ABSOLUE ! Pourquoi suis-je allée voir une bouffonnerie aussi débile que ce truc qui finit par faire marrer la salle tellement c’est absurde ? Et pourtant, je ne peux pas nier le fait que les prises de vues, la photo, les décors, les maquillages sont d’un excellent niveau, de même que le scénario, mais pourquoi avoir sombré à ce point dans l’outrance au risque de foutre en l’air le film ? Trop de moyens ? C’est fort possible. En fait, ils n’ont pas su s’arrêter à temps. Même le scénario - pas follement original mais disons que ça passe - finit par faire un gros flop ! En tout cas, on regarde toute cette mascarade de très loin sans jamais avoir la moindre émotion ni empathie pour les personnages qui finissent par être complètement ridicules eux aussi. Je suis rarement sortie aussi accablée après une séance de cinéma. Pas du tout mon truc ces guignoleries… Consternant.
En plus, c’est censé, paraît-il, être un film féministe ! Mais il ne l’est en rien, bien au contraire ! Car les images que ce film propose louent continuellement la beauté de la jeunesse tandis que la vieillesse apparaît comme monstrueuse. Ah, c’était du second degré ??!! Oui mais 2h30 de culs de jeunes femmes filmés plans serrés font oublier à bon nombre de spectateurs le second degré ma bonne dame !!! Rien n’est maîtrisé dans ce film, même pas le propos, c’est dire !
Deuxième long métrage de Coralie Fargeat