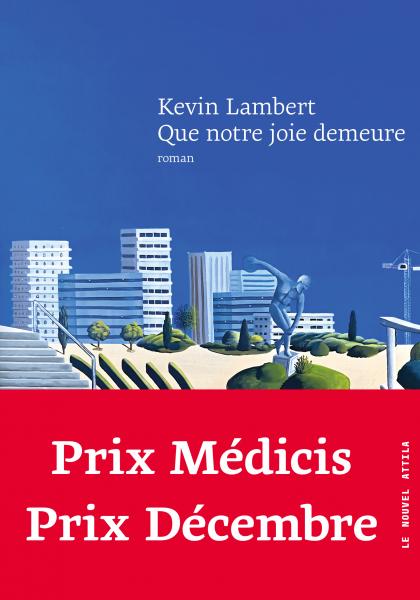Il
est arrivé à la médiathèque de Condé-en-Normandie avec ses
grosses chaussures de marche. En voisin, comme il dit.
En
effet, Garpard Koenig habite à Montilly-sur-Noireau, petite commune
de l’Orne. 720 habitants. C’est certain, ici, il a tout loisir de
les observer ses vers de terre ! Je connais bien la région, j’y
vis depuis fort longtemps. Pur hasard des mutations de l’Éduc
Nat ! Un peu le bout du monde. Beaucoup de vert. Mais, on s’y
fait ! Bon, les maisons ne sont pas chères et les terrains
encore moins.
En tout cas, c’est en observant les petites bébêtes
batifolant dans le sol que Gaspard Koenig a eu l’idée d’écrire
« Humus », un roman d’apprentissage contemporain
qui met en scène deux personnages pleins d’idéaux, sortant
d’AgroParisTech et qui vont vouloir trouver des solutions pour
améliorer l’état de notre planète.
L’un veut créer des
lombricomposteurs individuels pour que les gens puissent retraiter
leurs déchets organiques tandis que l’autre va quitter le plateau
de Sarclay pour un petit village de l’Orne (qui ressemblerait bien
à Montilly) afin de redonner un peu de vie aux terres malmenées du
grand-père. Ils vont se heurter tous deux aux illusions, aux échecs,
aux compromis. L’auteur explique qu’il n’a pas de solution,
qu’il n’y a pas de message dans ce roman, ce n’est pas un roman
à thèse. S’il avait des solutions, il aurait écrit un essai …
N’empêche qu’une question se pose : face au désastre
écologique, que fait-on ? Il s’est beaucoup documenté, s’est
rendu à Rouen pour visiter une usine de lombricompostage. Pour lui,
un roman doit être réaliste, notamment s’il parle de la société
dans laquelle on vit.
Pourquoi le choix des vers pour parler de
l’écologie ? Parce que c’est un sujet simple, on a vite
fait le tour de la question : 4 vidéos sur Google et un livre
de Marcel Boucher : « Des vers de terre et des
hommes », chez Actes Sud... Charles Darwin en 1881 (un an
avant sa mort) avait déjà parlé des vers de terre dans son livre
« La Formation de la terre végétale par l’action des
vers de terre.» J’ai consulté par curiosité la notice
Wikipédia et franchement, c’est passionnant… si, si… (vous aussi, quand vous aurez lu « Humus »,
vous ne verrez plus jamais les vers de terre de la même façon !)
Bref, Gaspard Koenig rappelle qu’ils forment la première biomasse
de la planète ! En effet, sur un hectare de terre se trouvent
trois tonnes de vers ! Impressionnant, hein ! En fait, on
ne regarde pas ce que l’on a sous les pieds. Notre tête est
constamment tournée vers le ciel… Et c’est bien dommage !
Souvenons-nous de la servante de Thrace qui rappelle à Thalès que
plutôt que de passer tout son temps à observer les astres, il
ferait mieux de regarder où il marche, ce qui lui éviterait de
tomber dans un puits.. Bref, les vers, c’est un sujet simple,
facile à aborder et surtout un sujet d’actualité car n’oublions
pas que le 1er janvier 2024, nous serons dans l’obligation
de traiter nos déchets organiques.
L’auteur
dit se sentir plus proche d’Arthur, il avoue aimer ces personnages
assez radicaux, lui qui passe son temps à faire des compromis, comme
nous tous d’ailleurs. En tant que philosophe de formation, il
explique qu’Arthur est du côté des intentionnalistes (une action
est bonne si les intentions sont bonnes) et Kevin des
conséquentialistes (la moralité d’une action dépend de ses
conséquences, utiles si possible) (Elizabeth Anscombe « Modern
Moral Philosophy » 1958) Autrement dit, ces derniers
considèrent que « dans un débat moral, on doit attribuer
plus de poids aux résultats d’une action qu’à toute
autre considération. »
Donc Kevin se lance dans la
création d’une start-up (largement manipulé par une femme parce
que l’on sent bien que ce n’est absolument pas son truc tout ça.)
La particularité des start-up, c’est qu’elles sont là pour
vendre des projets qui ne sont pas forcément rentables. Et Gaspard
Koenig de nous rappeler l’incroyable histoire de la start-up
Theranos, entreprise américaine fondée en 2018 par Elizabeth
Holmes, qui disait avoir trouvé le moyen de faire des tests sanguins
très peu coûteux. Elle lève rapidement d’énormes fonds
d’investissement (700 millions de dollars) et en 2015, son
entreprise « est valorisée à hauteur de 9 milliards de
dollars ». Le hic, c’est qu’à aucun moment l’entreprise
n’a proposé des tests fiables. Les dirigeants seront inculpés pour fraude massive et Mme Holmes sera condamnée à
plus de onze ans de prison, elle qui avait dîné avec les plus
grands de ce monde ! Mais sa technique n’était pas au point !
En fait, le fonctionnement des start-up est simple : prétendre
que c’est vrai jusqu’à ce que ça le devienne... Elle est belle
l’évolution des mécanismes économiques ! On marche
complètement sur la tête mais on n’est pas à une queue de vache
près, comme on dit chez nous. (là, c’est moi qui parle, pas
Gaspard, hein…)
Bon,
notre auteur considère que la fin de son roman est optimiste (avec
la plantation du hêtre…) et rappelle que Tchernobyl est devenu un
refuge pour deux cents espèces d’oiseaux et jouit d’une
bio-diversité absolument incroyable. Bref, la nature a repris ses
droits et les scientifiques de conclure que finalement, l’impact de
l’homme sur la nature est plus négatif qu’un accident nucléaire.
La zone est donc devenue un refuge pour de nombreuses espèces
menacées et les hommes sont priés de ne pas y mettre les pieds.
A la
fin de cet échange passionnant, nous avons bu quelques vers, pardon,
verres de poiré et j’ai retraversé mes champs sous la pluie en
imaginant tout ce qui se passait sous la semelle de mes vieilles
bottes en plastique.
C’est
chouette quand même la littérature, ça aide à trouver le bonheur
à portée de pied ….