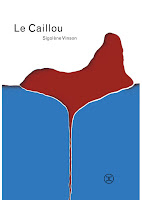Vivez-vous de vos livres ?
Non et à vrai dire, je n’y tiens pas. Je veux
que l’écriture reste une liberté, je ne veux pas avoir à me
dire : « Qu’est-ce que je pourrais bien écrire ? », je
ne veux pas « fabriquer un bouquin » mais, écrire un livre, sans
stress. J’ai besoin d’une vie professionnelle, je suis rédactrice sur un site
internet.
Parlons tout d’abord de votre
livre : Le dernier gardien d’Ellis Island, d’où vous est venue
l’idée du livre ?
Elle m’est venue d’un choc
provoqué par un lieu : Ellis Island. C’est un lieu que j’ai visité de
façon innocente. Ce n’était pas un lieu que j’avais choisi de visiter en
priorité d’ailleurs. J’ai été immédiatement frappée par l’empilement des
bagages dans le hall et j’ai ressenti une très forte montée d’émotion. J’ai été
littéralement saisie : l’exil n’était plus une chose abstraite, c’était
des gens. Je visitais ce lieu très tôt le matin, il n’y avait presque personne et
je me suis perdue dans les couloirs, j’ai regardé tous ces portraits en noir et
blanc, tous ces regards qui interrogent. J’ai senti, physiquement, quelque
chose de palpable. Je suis restée toute la journée dans un état second. Trois
semaines après, j’ai commencé à écrire. J’ai imaginé le journal du dernier
gardien de ce lieu vide chargé de toute cette mémoire. Comme je m’étais trouvée
seule dans ces couloirs, entendant au loin le cri des mouettes, j’ai ressenti
une forte impression de solitude.
On trouve souvent dans vos livres
un écho entre le passé et le présent.
Oui, en effet, je trouve
intéressante l’idée que le présent et le passé se parlent. Nous sommes des
héritiers, nous appartenons à une chaîne humaine. Même si on n’a plus le même
rapport au monde, le même rapport aux gens ou au temps qu’autrefois, il nous reste
un socle d’humanité que nous continuons à partager.
Quel a été le point de départ de
l’écriture de L’Ombre de nos nuits ?
J’écris de façon intuitive,
émotionnelle. Comme je l’ai dit, ça peut être un lieu qui va venir me submerger
et qui va ouvrir les portes de mon imaginaire et m’interroger de façon plus
intime.
Pour mon dernier livre, je me
trouvais à Rouen, j’avais un peu de temps avant de reprendre mon train et je suis
donc allée au musée et j’ai vu ce tableau : Saint Sébastien soigné par Irène d’après de La Tour qui est donc
une copie d’un original perdu. Cela a attiré mon attention, m’a touchée, a,
d’une certaine façon, ouvert une brèche. Et puis, ce visage d’une extrême
tendresse portée sur l’autre, sur celui que l’on aime. Ça m’a renvoyée à
quelque chose de plus personnel. Je me suis dit : c’est comme cela moi
aussi que je t’ai aimé… et l’écriture a eu lieu….
Dans ce roman, nous avons deux
histoires et trois voix avec des effets de miroir entre ces histoires et ces
voix
Oui, il y a tout d’abord la voix
du peintre dans son processus de création, qui renvoie d’ailleurs à l’écrivain
devant sa page blanche. Il y a une similitude dans le geste. Je trouve cela
fascinant : le rien, la page blanche, la toile vide puis l’émergence de
corps, d’un monde, de personnages.
De plus, j’ai essayé de mettre en
tension l’homme et l’artiste, le riche propriétaire ambitieux et violent,
voulant devenir le peintre du roi qu’était de La Tour alors que ce qu’il peint
n’est que douceur, amour. Il y a une forte contradiction entre l’homme dans sa
vie quotidienne et l’artiste qui va mettre le meilleur de lui-même dans ce
qu’il peint.
Par ailleurs, de La Tour avait
plusieurs filles dont une qui s’appelait Claude : j’ai pensé qu’elle avait
pu poser pour ce tableau. Quant au sujet, il a beau être un sujet religieux, on
ne remarque aucune référence religieuse appuyée : on voit plutôt un jeune
homme nu devant une jeune fille. C’est le côté intime, charnel presque érotique
qui domine.
La seconde voix est la voix du
jeune apprenti, orphelin de la Guerre de Trente ans, recueilli par le peintre
qui regrette certainement qu’il ne soit pas son propre fils, ce dernier n’ayant
aucun don pour la peinture.
Il y a entre ces personnages un
jeu de regards silencieux.
La troisième voix est celle d’une
femme qui s’est enfermée dans une histoire qui ne lui était pas destinée. Elle
s’est aveuglée.
Que ce soit cette femme ou ce
jeune apprenti, ce sont des gens qui aiment, qui sont capables de tout donner. J’aime
ces vers de René Char : « Donne toujours plus que tu ne peux
reprendre. Et oublie. Telle est la voix sacrée. » Cela renvoie à la
question de l’effacement par rapport à l’autre. Aujourd’hui, on baigne dans le
plaisir, la satisfaction immédiate de nos désirs. Ces notions de don, d’être
capable d’attendre sont importantes, me semble-t-il.
C’est un livre plus apaisé que
les précédents.
Comment avez-vous rédigé ces
voix ?
J’ai écris ces trois voix
séparément, j’avais besoin de me plonger dans chacune d’elles puis j’ai coupé,
ajusté, ce qui a été la phase la plus délicate. Il fallait que je sois
attentive aux enchaînements. Et puis, au départ, j’ai mis en place une
quatrième voix, celle de Claude mais je l’ai supprimée, cela faisait trop.
Comment organisez-vous votre
travail d’écrivain ?
J’écris en deux temps : tout
d’abord, je raconte mon histoire, c’est la phase de création pure, la plus
exaltante. J’écris comme ça vient. Puis la seconde phase : celle du
travail. Je relis et relis. Je me penche sur la ponctuation qui est essentielle
pour la musicalité de la phrase. L’écriture est liée au souffle comme le chant.
Je m’interroge sur l’image, l’adjectif inutile. J’ai d’ailleurs compris que, lorsqu’on a un doute, il faut supprimer ! Comme le disait Duras, il faut
« faire du mot le bel amant de la phrase. » Je me demande toujours
quel est le mot juste qui va faire résonner la phrase. Je cherche aussi la
bonne cadence. J’aime les ruptures de ton, de rythme. Mais attention, le but
n’est pas de faire de jolies phrases. Je ne veux pas qu’elle sonne creux. Si la
phrase est belle, c’est bien, mais si elle est juste, c’est beaucoup
mieux !
Vous parlez de l’écriture comme
de la musique, êtes-vous musicienne ?
Oui, je joue du piano. Mais je
considère l’écriture comme une consolation : celle de n’être pas douée en
musique. C’est vrai que j’ai l’impression d’écrire à l’oreille : parfois
je sens qu’il manque une syllabe ou qu’il y en a une en trop…. Je pensais pour
ce livre à des suites pour violoncelle de Bach.
Vos textes sont tous assez
courts.
Oui, j’aime la tension du texte
qui est plus difficile sur un texte long. J’aime que l’auteur soit tenu,
maintenu par le texte.
Il vous faut combien de temps
avant de vous mettre à écrire ?
Ecrire, c’est attendre la vague.
Je n’écris pas tout de suite, j’attends que ce soit bien mûr !
Avez-vous des projets ?
Oui, pour la fin de l’année, chez
un petit éditeur : « Le temps qu’il fait ». C’est un
fragment de prose autour de la voix. Je trouve le monde actuel très visuel et
certainement trop bruyant, or je suis attentive aux voix.
Merci à la librairie Doucet
d’organiser de si belles rencontres et à Gaëlle Josse d’être venue à ce
rendez-vous…