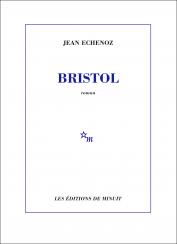Éditions Actes Sud
★★★★★
Le projet était pour le moins ambitieux : écrire une histoire
linguistique de Paris et de sa périphérie, des origines jusqu’au
XXIe siècle ! Eh bien, le pari est gagné et le livre vraiment
passionnant. Parler de la langue, c’est bien évidemment parler de
politique, d’économie, d’art, de mouvements migratoires, de
mœurs etc. Autant dire qu’on lit aussi une Histoire de la Capitale
voire de la France. Parler d’une langue, c’est aussi parler des
autres langues, celles des régions et celles de l’étranger car
les apports sont évidemment toujours très nombreux. Bien entendu,
l’autre problématique est celle d’une norme que l’on veut
imposer : la langue de la Capitale. Pourquoi elle et pas les
autres ? Mais quelle est-elle au juste cette langue de la
Capitale ?
Allez,
je vous en dis deux mots pour vous donner envie de vous lancer dans
la lecture de ce texte qui se lit comme un roman.
Tout
commence en 53 av.J.-C : Jules César réunit les chefs gaulois
sur une île de la rivière Sequana où se tenait l’oppidum des
Parisii. Il appelle ce lieu Lutecia Parisiorum : « la
Lutèce des Parisii ». Cette Lutèce comporte entre 2000 et
5000 habitants concentrés sur la rive gauche, au pied de la montagne
Sainte-Geneviève. Autour, il n’y a que forêts et marécages. Les
habitants parlaient gaulois, langue utilisée pour la vie
quotidienne. Pour tout ce qui est administratif, on utilise le latin.
Les deux se mélangent constamment. Bien plus tard, au XI e siècle,
le picard, le wallon, le poitevin-saintongeais ainsi que le normand
seront très influents. Le normand insulaire conquiert la place de
langue littéraire notamment à travers les « Lais »
de Marie de France. Le picard et le champenois se développent dans
la tradition littéraire à travers l’oeuvre de Chrétien de Troyes
à l’origine du cycle du Graal. Le centre de Paris est l’île de
la Cité où siège une communauté de prêtres : ils étudient
et copient des manuscrits. L’étude se fait en latin. Paris attire
les étudiants de toutes les capitales voisines : ils sont 10
000 sur une population de 100 000. En 1253, Pierre de Sorbon crée
La Sorbonne : l’université est un monde cosmopolite et
polyglotte. Les étudiants échangent dans un latin oral que l’on
ne prononce pas de la même façon selon le pays d’où l’on
vient. Qu’est-ce que le français au XIIIe siècle ? C’est
un joyeux mélange de picard, normand, bourguignon et d’un parler
d’Île de France. Vous y ajoutez du latin et des langues étrangères
et vous devriez à peu près y être ! En tout cas, à Paris, il
n’y a pas encore d’activité littéraire comme en Normandie, en
Picardie ou en Champagne.
Dès
le XIVe, la connaissance du latin diminue rapidement, les médecins
pratiquent, sans connaître le latin, ce que la Faculté de Paris
leur défend de faire. Les néologismes sont nombreux car c’est une
époque de progrès technique. On crée des mots qui permettent une
compréhension facile : « vinaigre », « culbuter »,
« garde robe ». Nul besoin de connaître le latin pour
comprendre ces mots !
C’est
en 1539, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts que François Ier
demande que les actes soient formulés « en langage maternel
françois et non aultrement. » Jacques Lefèvre d’Étaple
traduit la Bible en français en 1530 mais à Anvers car la
traduction sera condamnée par la Sorbonne. De la même façon, le
milieu juridique veut conserver l’usage du latin pour entretenir un
esprit de corps. Le latin est au XVIe siècle toujours la langue des
études. Sous l’égide de Guillaume Budé est créé le Collège
royal, futur Collège de France : il s’agit pour les
professeurs qui y enseignent de mieux connaître la Bible et les
textes anciens dans leur version originale. En 1455, Gutenberg fait
imprimer le premier livre : la première presse du royaume est
installée à Paris dès 1470. L’imprimerie va obliger à fixer
l’orthographe des mots et donc cela ralentira l’évolution de la
langue ! Au XVIe, Paris est à la mode italienne et à la fin du
même siècle, c’est la mode du Gascon qui l’emporte !
Au
XVIIe, les Salons vont de pair avec une recherche du raffinement.
Malherbe s’attelle à « dégasconner » le
langage de la cour d’Henri IV, jugée grossière. On veut donner
des règles à la langue, en créant par exemple un dictionnaire puis
une grammaire, une rhétorique et une poétique. C’est le « bon
usage » que Vaugelas définit dans ses « Remarques
sur la langue française » de 1647. Le centre du bon usage
est Paris et au centre de Paris, la Cour. Comme on le voit dans
certaines pièces de Molière, les provinciaux sont ridiculisés :
le Breton par exemple est : « grossier, ivrogne et
mystique » Comme le dit Vaugelas, « Quelque effort
que fassent les Provinciaux pour bien parler… il ne leur reste je
ne sçai quelle crasse dont ils ne sçauroient se defaire. »
Voilà, c’est dit ! C’est la naissance de l’opposition
Paris/province.
Le
XVIIIe voit les grands auteurs s’éloigner du latin. Voltaire
dira : « Je savais du latin et des sottises. »
C’est aussi la naissance des bibliothèques appelées « cabinets
de lecture ». Les gens lisent beaucoup. Le bon français
n’est plus celui de la Cour, à Versailles depuis 1682, c’est à
dire loin de Paris. La Cour continue à prononcer en oué les mots
graphiés en oi, tandis qu’à Paris, les snobs prononcent le oi en
è et disent mémère pour mémoire. Tout le monde dit cet homme-cy,
ce temps-cy tandis qu’à la Cour, on aime dire cet homme icy, ce
temps icy…
À
la Révolution, la France est un pays rural, le taux d’urbanisation
est de 18 pour cent. La Révolution est farouchement contre les
parlers locaux et les langues régionales. 6 millions de citoyens
(sur 28 millions) ne parlent pas un mot de français. L’abbé Henri
Grégoire présente à la Convention en juin 1794 son « Rapport
sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et
d’universaliser l’usage de la langue française ».
Condorcet pense que le français sera ainsi une « langue de
l’égalité » en « cessant de séparer les
hommes en deux classes » . On ne mesure plus en coudes et
lieues mais en mètres et kilomètres, on se tutoie et l’on
s’appelle Citoyen. En 1793, on dissout l’Académie, selon Marat
une assemblée de « quarante fainéants » qui ne
s’intéressent qu’au « beau langage » et
au « beau monde ».
Au
XIXe, lors de la création des lycées, on veut diffuser un français
national. On étudie la grammaire, on pratique l’analyse logique.
On apprend par coeur les classes de mots (clin d’oeil à mes petits
collégiens!) En 1881, cette éducation devient obligatoire, laïque
et gratuite pour tous. On travaille l’orthographe. Et paraît-il
qu’il y a du travail, notamment dans les classes élevées où l’on
considérait que c’était une affaire de bourgeois. C’est
l’époque des manuels de conjugaison des frères Bescherelle
(1842). On articule le français avec soin et l’on prononce à
l’oral les doubles consonnes d’« affamer » et
de « collection » ! Encore une fois, la mode
anglaise va se répandre et s’infiltrer dans la langue française :
on fera du « tennis », du « rugby »
et du « golf » ! Et l’on ira au
« music-hall » ! Paris vivra aussi une
immigration « de l’intérieur » : celle des
Savoyards par exemple ou des Bretons. Sachez quand même qu’au
XIXe, le français reste largement inconnu en Bretagne. Les
trois-quarts des Bretons ne parlent que le breton ou sont
analphabètes. Pensez à notre Bécassine !
Je
vous laisse imaginer ce qui a fait notre français du XXe siècle:
les guerres, l’immigration, les métissages, le tourisme…
Et
j’y pense, je ne vous ai pas parlé des différents jargons :
celui des crieurs de rue, des « escholiers »
rabelaisiens, des précieuses, des poissardes, des snobs, des dandys,
des titis, des gavroches, des loubards, des branchés etc etc...
Voici
donc un bref aperçu de ce livre incroyable qui permet vraiment de
comprendre ce qu’est une langue, à savoir quelque chose de vivant
qui s’enrichit constamment des apports étrangers, toujours en
mouvement. Je vous recommande vraiment ce texte qui se lit comme un
roman et qui m’a vraiment enchantée.