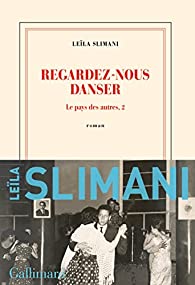Je ne sais pas pour Marcel (on se tutoie maintenant, on vient de
passer une semaine ensemble!), mais moi, je n’ai pas perdu mon
temps ! Assignée à résidence à cause d’une sale
labyrinthite qui me donnait l’impression d’être plutôt un
personnage kafkaïen que proustien, je me suis replongée dans « La
Recherche ». Ben voui ! J’ai même pris la décision
de tout relire et d’essayer d’y comprendre quelque chose !
(Je n’ai peur de rien !) Alors voilà, j’ai noté deux trois
réflexions que je vous livre (vous avez hâte, je sais), dont on
pourrait discuter (n’hésitez pas à partager votre point de vue!)
et surtout, je me suis dit qu’elles pouvaient (éventuellement) me
permettre une entrée dans l’oeuvre, histoire de ne pas m’y
aventurer sans lampe frontale… Ici, je parle surtout de la partie
intitulée « Combray ». Allez, on se lance ?
Promis, après la lecture de cet article, si entre la poire et le
fromage, la discussion tourne sur « La Recherche »,
vous aurez de quoi tenir jusqu’au café !
Alors,
pour commencer, il me semble qu’il y a dans le motif du vitrail
(essentiel à mon avis), présent à la fois dans l’église
d’Illiers-Combray et le Salon des Dames de Tante Léonie, un
éclatement et une opacité qui préfigurent le regard du narrateur
sur le monde. « La Recherche » est en effet une
tentative de déchiffrement, de dévoilement, d’accès à une
vérité toujours en fuite. «… La chose vue par
moi, de mon côté du verre, qui n’était nullement transparent, et
sans que je puisse savoir ce qu’il y avait de vrai de l’autre
côté... » Si on regarde bien, le Narrateur passe son
temps à lire le monde, à tenter de l’interpréter, d’accéder à
l’essence des choses c’est-à-dire à leur beauté, leur vérité.
Il formule constamment des hypothèses, des postulats sur les gens,
les lieux, les temporalités, les soumettant à une grille de lecture
qu’il fait évoluer au fil du temps et qui s’apparente à
différents points de vue successifs sur le monde. Le Narrateur
s’efforce donc d’interpréter les signes : il tâtonne,
commet beaucoup d’erreurs d’ailleurs, nous entraîne avec lui
dans des analyses souvent erronées ou partiales. Il croit percevoir
la lumière derrière le verre opaque mais c’est un leurre. Tout
est à reprendre, toujours, sans cesse, et il faut attendre que
d’autres expériences sensorielles se présentent pour tenter comme
le dit M. Raimond de « passer de l’impression à
l’expression » (que c’est bien dit!) car évidemment
bien sûr, vous vous en doutez, le but de l’entreprise est
(roulements de tambour) de parvenir au Graal, c’est-à-dire à
l’Art et notamment à l’écriture.
Donc
« La Recherche » se présente comme un roman
d’initiation, d’apprentissage. Mais l’accès à une éventuelle
vérité semble un chemin semé d’embûches et on va voir pourquoi…
Tout
d’abord, l’emploi du temps très strict du Narrateur (pauvre
Marcel… si j’imposais ce genre de rythme à la maison, ça serait
la révolution!) ne lui permet pas de créer véritablement de
perméabilité entre les heures de la journée, chacune d’elles
enfermant sa propre vérité dans l’espace qui lui est imparti.
Cela fonctionne exactement de la même façon pour les lieux :
les espaces sont étanches, hermétiques, clos : comment
envisager que la promenade du côté de Méséglise (courte et donc
souvent effectuée les jours de mauvais temps) puisse croiser celle
de Guermantes - plus longue et occupant donc les jours les plus
clairs ? On voit bien d’ailleurs ici l’étroite imbrication
lieux /temporalités qui accentue encore davantage l’effet de
quadrillage. En effet, les lieux comme les temporalités sont
morcelés, divisés comme des pièces de puzzle impossibles à
assembler et en même temps, chose surprenante, ils peuvent à
certains moments se superposer voire se confondre. (Je vois aussi
dans les « paperoles » rattachées les unes aux autres,
parfois de manière hasardeuse, par Céleste et comme repliées en
accordéon, cette même tentative d’accéder à la vérité par
ajouts successifs, par petites touches, collages de fragments.) Il
suffirait pourtant de réunir les pièces pour qu’un sens
apparaisse, pour qu’une unité première (un paradis perdu
peut-être?) soit retrouvée. Mais comment ? C’est bien là le
problème ! Le morcellement de toute chose provoque chez le
Narrateur inquiétude, tourment, souffrance. Prenons l’exemple de
l’expérience du train : « je passais mon temps à courir
d’une fenêtre à l’autre pour rapprocher, pour rentoiler
les fragments intermittents et composites de mon beau matin écarlate
et versatile et en avoir une vue totale et un tableau continu. »
Cette course est le reflet d’une quête, elle est action, volonté,
recherche. C’est une expérience difficile, épuisante et souvent
stérile : elle ne permet pas d’accéder au mystère des
choses. Elle le laisse seulement pressentir : le Narrateur
entrevoit une lumière et des signes mais il ne parvient pas à les
déchiffrer. C’est l’échec. Il a besoin d’une vue synthétique,
globale, totale pour qu’une lecture du monde soit possible et, bien
sûr, qu’une écriture puisse advenir. En effet, tant qu’il ne
parviendra pas à effectuer cette agrégation/fédération,
l’écriture n’aura pas lieu. CQFD.
En
effet, comme on vient de le voir, le narrateur a une lecture
particulière du monde, une vision fractionnée qui l’empêche de
prendre en compte un ensemble, une totalité. Et c’est bien ça le
problème ! La synthèse lui est rarement possible, et pourtant,
elle est nécessaire à l’écriture, à la captation de l’essence
des choses, de leur vérité. Il décrit d’ailleurs cela comme une
sorte de handicap qui lui est propre. En effet, à cette vision
morcelée de l’univers s’ajoute un moi fragmenté, les deux étant
certainement liés d’ailleurs : « ...c’est du côté
de Guermantes que j’ai appris à distinguer ces états qui se
succèdent en moi, pendant certaines périodes, et vont
jusqu’à se partager chaque journée, l’un revenant
chasser l’autre, avec la ponctualité de la fièvre :
contigus, mais si extérieurs l’un à l’autre, si dépourvus de
moyens de communication entre eux, que je ne puis plus comprendre,
plus même me représenter dans l’un, ce que j’ai désiré ou
redouté, ou accompli dans l’autre. » On observe ici un
éclatement du moi qui empêche une compréhension du réel. Face à
cet aveu d’incapacité, le Narrateur en vient à formuler
l’hypothèse que finalement « la réalité ne se forme que
dans la mémoire… les fleurs qu’on me montre aujourd’hui pour
la première fois ne me semblent pas de vraies
fleurs. » Autrement dit, pour lui, le réel possible
n’appartient qu’au passé, il est recomposition, ce qui signifie
qu’il est étroitement lié au monde de l’Art et que seul l’Art
peut en proposer une représentation possible.
Alors,
à quoi ressemblent les lieux réels dans la tête de Marcel?
Souvent disjoints, il
arrive qu’ils se superposent et donc d’une certaine façon
se confondent : lorsque devenu adulte, le soir, le Narrateur
entend des aboiements de chien, il se croit sous les tilleuls près
de la gare de Combray. Le lieu présent s’efface et laisse place au
lieu passé dans une espèce de procédé de surimpression qui n’est
pas sans rappeler les formes projetées par la lanterne magique sur
le mur de la chambre. Cette
superposition crée un
autre lieu, composite,
irréel, j’allais dire romanesque. En tout cas, apparaît un espace
qui n’existe pas, une création liée à une impression, à une
expérience particulière. Ici l’unité engendre l’Art, elle
permet d’atteindre une forme de Vérité supérieure à celle du
réel, trop souvent
décevante.
Voici
un autre exemple : il
est très étonnant de
constater qu’il suffise
que le père du Narrateur emprunte un chemin différent pour que
toute
la famille soit perdue, sans repères dans un espace pourtant
extrêmement familier
et très limité.
Le père apparaît dans
ces moments-là comme le
magicien qui d’un coup de baguette magique retrouve la petite porte
de la rue du Saint-Esprit. Cela
me semble
lié aux représentations que le
Narrateur et sa mère ont de l’espace qui dans leur esprit n’est
pas segmenté par des routes,
des chemins, des
directions… Pas de carte, pas de GPS dans leur esprit. Non,
ce sont plutôt des
lieux-instants,
des lieux-paysages,
des lieux-sensations,
des lieux
qui finalement ont plus à voir avec des caractéristiques
esthétiques
que géographiques. Ainsi,
pourrait-on penser que ce point de vue
sur le monde favoriserait l’accès à l’Art.
Ce n’est pas le cas : les lieux ainsi vécus ne
permettent pas d’accéder à la vérité. On
verra plus tard que Swann, qui a une vision artistique du monde,
(c’est certainement l’homme le plus cultivé de La Recherche) ne
fera rien de tout cela. Certainement, parce que cela ne suffit pas.
De
même l’onomastique crée dans l’esprit du Narrateur des images,
des visions souvent bien éloignées du réel. Prenons l’exemple de
Balbec : Legrandin
explique que Balbec est un lieu de « tempête
en fin de terre ».
Swann précise que son église s’apparente
au gothique normand. Bref
Balbec restera à jamais dans l’esprit du Narrateur un assemblage
étonnant
et superbe d’architecture
gothique et de tempête sur la mer et, comme le fait remarquer R.
Barthes dans
« Le degré zéro
de l’écriture », « Proust et les noms » :
Balbec « a
deux sens simultanés.»
- sans
même parler des sonorités (harmonies imitatives) qui pourraient
encore conduire le narrateur vers d’autres visions.
Avant même de connaître
les lieux, le Narrateur va
tenter de déchiffrer les
noms, de déceler les mystères du monde à travers eux. Il dispose
librement de ces noms, personne ne lui en barre l’accès, il va
donc y déverser toute la puissance de son imagination. Là, va
s’opérer une reconstruction du lieu qui
va engendrer une espèce
d’entité nouvelle, poétique,
artistique.
N’oublions
pas que lorsque le
Narrateur était enfant, à
la demande de sa grand-mère, on ne lui offrait pas
des
photos
des lieux qu’il aurait
aimé visiter car
elles étaient
jugées vulgaires. A la
place, Swann lui rapporte des photographies
de chefs-d’oeuvre (peintures
ou gravures anciennes) afin de placer entre le réel et la
représentation du réel le maximum d’« épaisseurs »
possibles.
Ainsi, la
représentation que l’enfant se fait des lieux n’a strictement
rien à voir avec les lieux eux-mêmes. Le
réel est jugé
vulgaire, laid. Il vaut
mieux s’en tenir
éloigné…
L’enfant est élevé
dans une forme de rejet, de condamnation du réel. Peut-il
faire autre chose que chercher
une issue pour accéder au monde ?
Et
pourtant, tout se passe
comme si certains moments privilégiés
avaient le don d’unir,
de rassembler le temps et
l’espace et ce sont précisément ces expériences-là
qui donnent accès à l’Art
et donc
l’écriture. Prenons l’exemple des clochers
de Martinville : tandis que le Narrateur est sur le point de
renoncer à être « un écrivain célèbre » parce qu’il
ne parvient pas à découvrir ce qui se cache derrière les choses et
qu’il perd la volonté de s’adonner à cette recherche
nécessitant
un effort important, il est invité, lors d’une promenade, à
monter à côté du cocher
dans la voiture du docteur
Percepied. Il aperçoit au
loin les clochers de
Martinville sous le soleil couchant et une impression l’étreint.
« Je
sentais que je n’allais pas au bout de mon impression, que quelque
chose était derrière ce mouvement, derrière cette clarté, quelque
chose qu’ils semblaient contenir et dérober à la fois. »
C’est peut-être un détail mais à ce moment précis, soudain,
l’espace s’annule : alors
qu’il croyait les
clochers éloignés, la
voiture arrive de façon
très soudaine devant l’église. Le
Narrateur demande
immédiatement de quoi
écrire. En fait, le
mystère de
ces clochers, c’est qu’ils offrent au narrateur la
possibilité d’accéder
à l’écriture. Là,
le jeune homme le comprend
et il agit
immédiatement, en
demandant de quoi écrire et en
écrivant. En fait, ce ne sont pas les clochers qui détiennent
l’essence des choses, c’est l’expérience que le Narrateur fait
avec ces clochers, quelque chose qui a lieu dans son esprit, en
lui-même. Or,
comme je le précisais
tout à l’heure, on a
l’impression que ces moments privilégiés ne
peuvent exister
que s’il n’y
plus de fragmentation spatiale ou temporelle. Il faut un lieu unique
(une abolition de l’espace), un temps unique
(une absence de
fragmentation temporelle qui a lieu précisément
dans les expériences de
mémoire involontaire où le présent s’efface au profit du
passé .) En effet,
l’analogie entre la
sensation présente et la sensation passée annule la distance
temporelle et permet de « s’affranchir de l’ordre du
temps » et d’atteindre l’essence des choses. Et
peut-être que ce lieu unique, privilégié, est la chambre, espace
clos, lieu de l’écriture,
lieu de l’immobilité où toutes les distances sont annulées.
Devenu adulte, le
Narrateur, lorsqu’il se réveille le matin, ne sait plus ni dans
quelle pièce
il se trouve
ni quelle heure il est. Il
est dans un lieu qui
pourrait être tous les lieux et hors
du temps. Genette précise dans « Figures
I », « Proust
palimpseste »,
que « le temps
perdu n’est pas
chez Proust … le passé, mais le temps à l’état pur,
c’est-à-dire en fait, par la fusion d’un instant présent et
d’un instant passé, le contraire du temps qui passe :
l’extra-temporel, l’éternité. »
Cela
fonctionne de la même façon pour les gens : l’imagination du
Narrateur s’empare d’eux, les idéalise parfois, les invente,
les crée : le cas de Gilberte est particulièrement
intéressant. Voici les paroles pour le moins étonnantes du
Narrateur : « Si elle n’avait pas eu des yeux aussi
noirs… je n’aurais pas été, comme je le fus, plus
particulièrement amoureux, en elle, de ses yeux bleus. »
Quel paradoxe incroyable ! Le Narrateur s’avoue incapable de
« réduire en des éléments
objectifs une impression forte », autrement dit,
sous le poids d’une quelconque émotion, il lui est impossible
d’accéder à une vérité qui aurait quelque chose à voir avec
une approche objective du réel.
Le
Narrateur n’est d’ailleurs pas le seul ne pas comprendre le
monde : que connaît-on de Swann ? Chacun en a une vision
très partielle donc fausse. Comme le fait remarquer Genette, « tous
les personnages de la Recherche sont protéiformes », donc
insaisissables. Et ce qui est frappant, c’est que dans la mesure où
ils ne sont pas perçus dans une continuité, on est toujours surpris
de découvrir soudain ce qu’ils sont devenus. Swann ne supporte
plus Odette ? On les retrouve mariés. Ils peuvent même
simultanément associer des caractères contraires : être à la
fois médiocres et fascinants, doux et violents.
Comme
pour les lieux, le Narrateur passe par l’Art pour imaginer les
gens : « Mme de Guermantes, que je me représentais
avec les couleurs d’une tapisserie ou d’un vitrail »
déçoit lorsqu’il la découvre : l’image qu’il s’est
faite d’elle ne « coïncide » pas
avec le réel, ce qui donne lieu évidemment à une forte déception
« c’est cela, ce n’est que cela, Mme de
Guermantes! » Dans le réel, elle n’est pas « colorable
à volonté » (j’adore cette expression!), elle est
réduite à une image fixe, elle est assujettie « aux lois
de la vie ». Dans le monde de l’Art, elle acquiert un
prestige, une aura qui disparaît complètement dans le réel.
Le
Narrateur pense que l’Art doit lui permettre d’accéder à la
vérité. Il est d’ailleurs interloqué lorsqu’il entend dire par
son camarade Bloch que « les beaux vers étaient (à moi qui
n’attendais d’eux que la révélation de la vérité) d’autant
plus beaux qu’ils ne signifiaient rien. » Il attend de
l’Art qu’il lui offre non seulement l’accès aux mystères du
monde mais aussi qu’il compense une réalité toujours assez
décevante.
Je
voudrais pour finir (oui oui, ça se termine!) aborder une figure de
style essentielle dans l’écriture proustienne à savoir, la
métaphore : en effet, elle met en évidence les points communs
entre les choses, elle réunit au lieu de séparer, établit des
liens, des ponts entre des univers que l’on croyait hermétiques,
elle dit que chaque chose participe du grand tout, elle exprime
l’unité d’un monde, vision nécessaire, comme on l’a vu, pour
accéder à sa beauté, à sa vérité, elle permet de dépasser les
apparences :« Si on cherche
ce qui fait la beauté absolue de certaines choses….
on voit que ce n’est pas la profondeur, ou telle ou
telle vertu autre qui semble éminente. Non, c’est une espèce de
fondu, d’unité transparente, où toutes les choses, perdant leur
premier aspect de choses, sont venues se ranger les unes à côté
des autres dans une espèce d’ordre, pénétrées de la même
lumière, vues les unes dans les autres, sans un seul mot qui
reste en dehors, qui soit resté réfractaire à cette
assimilation… » (A l’ombre) La métaphore pour
reprendre l’expression de C.E Magny « opère sur les
choses une délivrance », elle les rassemble dans l’espace
et dans le temps. Elle permet à l’artiste de révéler ainsi
l’essence réelle des choses et « d’atteindre ce qu’il
y a d’éternel dans le monde. » Et c’est précisément
la phrase proustienne, à travers l’usage de la métaphore et de la
comparaison, qui détient la clé permettant d’accéder à cette
éternité. Comme le précise Gérard Genette dans son article
« Proust palimpseste », « Figure I » :
« la métaphore n’est pas un ornement, mais l’instrument
nécessaire à une restitution, par le style, de la vision des
essences parce qu’elle est l’équivalent stylistique de
l’expérience psychologique de la mémoire involontaire »
Ainsi la métaphore concrétise-t-elle dans l’écriture elle-même
cette nécessaire fusion, cette indispensable convergence entre deux
entités permettant d’accéder à une vision totale, absolue,
apaisée du monde nécessaire à l’acte d’écriture.
Nous
le savons, contrairement au Narrateur, Swann a échoué, il s’est
perdu, a perdu son temps, n’est pas allé à la recherche de la
vérité. Il n’a pas choisi entre l’Art et la vie. Il a fréquenté
les salons, les mondains. Il a bien senti qu’il n’était pas loin
parfois d’une révélation. D’ailleurs, il est le seul personnage
de La Recherche à vivre une expérience de mémoire involontaire
similaire à celle du Narrateur à travers la petite musique de
Vinteuil. Mais il n’a pas approfondi, n’a pas pris le temps, n’a
pas répondu à l’appel. Il serait intéressant de se demander en
quoi Swann apparaît comme le double négatif du Narrateur. Pourtant,
tout laisse penser qu’il faisait partie des élus, qu’il aurait
pu, qu’il n’a peut-être pas été loin « de faire une
œuvre d’art ». Pourquoi s’est-il arrêté « en deçà
de l’art » ? Qu’est-ce qui a empêché Swann d’accéder
à la création ? (suspense atroce ...)
Allez,
je vous laisse là-dessus. Dites-moi où vous en êtes avec Proust :
lecture, relecture, abandon? Quel rapport avez-vous avec cette
œuvre ? Dites-moi tout !