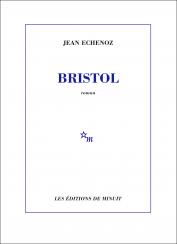Bon,
maintenant, je vous préviens tout de suite, cela ne m’a absolument
pas dérangée. Bien au contraire! J’ai trouvé ce texte
dé-li-cieux, j’ai adoré suivre l’auteur dans ses aventures
rocambolesques et je conseille à tous de lire cette épopée sur les
pas du Che.
Alors
d’où vient cette impression ?
D’abord
Désérable ne décrit pas ou peu les lieux qu’il traverse. Il le
dit lui-même à plusieurs reprises. J’ai d’ailleurs fait pas mal
d’allers-retours entre le livre et mon portable pour voir un peu à
quoi ressemblaient les paysages évoqués. « Nous vîmes les chutes
d’Iguazú, que je ne décrirai pas : ne me viendraient que des
superlatifs sans intérêt, qui ne diraient rien à qui ne les a
jamais vues. » S’ensuit une très longue prétérition
dans laquelle, finalement, il décrit rapidement ces fameuses chutes.
On pourrait d’ailleurs lui souffler que c’est un peu le rôle
d’un auteur que de trouver les mots pour décrire ce qu’il voit,
et ce, sans utiliser des « superlatifs sans intérêt. » Bref, ces
chutes, je suis allée les contempler sur le petit écran de mon
portable. Mais pourquoi pas.
En
fait, Désérable parle surtout des gens. Ce sont toujours des
rencontres incroyables (précisément) et elles arrivent quasiment
toutes les quatre pages, pour notre plus grand plaisir de lecteur, il
faut bien le dire! Généralement elles foutent un peu la trouille
mais elles se terminent bien et comme Désérable a le sens de la
formule, on finit par en rire. Un vrai plaisir ! Il est vraiment doué
Désérable pour se trouver là où il faut au bon moment. Mais,
impossible de croire à tant de coïncidences folles, hasards
étonnants, imprévus abracadabrants, concours de circonstances
exceptionnels, veine surprenante. Impossible. Mais ce n’est pas
grave, on adore, on frémit, on rit. On se souviendra beaucoup plus
des bidonvilles de Lima grâce à l’anecdote qu’il nous raconte
que s’il nous avait décrit les lieux de long en large de façon
impersonnelle. Non, l’anecdote, elle restera dans notre mémoire !
D’ailleurs, une minuscule note de la page 178 nous révèle que oui
« parmi toutes les scènes de ce récit, l’une d’elle est
fictive. » Une seule vraiment ? Allez, allez…
Parfois
j’ai même pensé qu’il n’avait peut-être même pas quitté sa
Butte Montmartre. Un plan des lieux, Wiki & compagnie et beaucoup
d’imagination : voilà le tour est joué. L’auteur aime Romain
Gary. Je le soupçonne d’avoir lui aussi ce petit côté espiègle,
un peu farceur sur les bords et ça serait plutôt rigolo de bluffer
génialement tout le monde de cette façon, non ?
Une
autre chose : j’ai écouté plusieurs interviews de Désérable au
sujet de ce livre. Eh bien il raconte toujours exactement les mêmes
épisodes, jamais un autre, un nouveau, un truc qu’il aurait vécu,
qu’il n’aurait pas mentionné dans le livre et qui lui serait
revenu là, juste au moment de l’interview. Non, toujours
exactement les mêmes souvenirs et souvent racontés avec les mots
mêmes utilisés dans le livre. Comme si ces souvenirs n’étaient
que littérature. Comme s’il récitait une leçon bien apprise.
Oui
mais les quelques photos du livre. Alors là, on sait qu’une photo
ne prouve plus rien.
Bref,
c’est un super bouquin, je l’ai adoré ! Peu importe qu'il y soit
allé ou pas d'ailleurs. Dans le fond, on s'en fout ! Il m’a
quasiment donné envie de découvrir l’Amérique du Sud où je ne
rêvais vraiment pas d’aller. C’est vous dire...
UN JOUR PLUS TARD:
Ben voilà, je me suis plantée. Ok, ça arrive à tout le monde et heureusement qu'il y a des auteurs VIVANTS capables de nous dire: pas du tout, revois ta copie ! (La veille d'une rentrée, ça fait bien!)
Que je vous raconte... Hier, je poste ma petite chronique IG sur "Chagrin d'un chant inachevé" de François-Henri Désérable. Je disais que je ne croyais pas à toutes ces aventures extraordinaires et j'imaginais (avec beaucoup de plaisir et de malice d'ailleurs) que l'auteur était peut-être même resté "at home" pour écrire ce texte.
Je poste.
Très vite je reçois plusieurs photos en MP de F-Henri Désérable, des photos incroyables où on le voit faire du stop, avec les mineurs de Potosi, avec Kiko dans la jungle amazonienne, sous la tente avec l'Odyssée, lors de la panne dans le désert chilien, avec une mygale sur la joue🕷 (bon, ça, c'est pas dans le livre et il faudra qu'il nous raconte cette aventure!), à l'observatoire astronomique et d'autres encore... Avec, cerise sur le gâteau, une video des chutes d'Iguazú... Oh JOIE ABSOLUE! 🎉🎊 Le genre de truc qui te refait ta journée!!!! Imaginez! Je reçois un trésor.... Je suis sur un nuage!
Ok j'ai dit des conneries. Mais enfin pas complètement quand même parce que ce livre est génial et ça, je n'en démords pas ! C'est mieux qu'un voyage car quand vous lirez tout ce qui lui arrive... 😬 Impressionnant!!! Franchement, j'aime mieux lire tout ça dans le fond de mon lit! N'empêche que, si un jour F-H Désérable cherche un.e partenaire pour crapahuter, retenez-vous parce que vous risquez gros. Mais c'est ça la littérature: ce sont les malheurs, la poisse, l'adversité qui font les grands récits.
Merci à lui en tout cas pour ces photos extraordinaires que je garde bien précieusement dans mon panthéon personnel. 💚
Dernière chose : si les ÉDITIONS GALLIMARD pouvaient les éditer, ce serait un vrai cadeau pour les lecteurs !